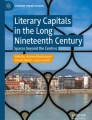Abstract
The article aims at rendering how the negotiation of the multilingual inheritance in the Austro-Hungarian Empire worked in Liviu Rebreanu’s case. Generally esteemed as the most important novelist of the interwar period, Liviu Rebreanu (1885–1944) was educated—both as an intellectual and as a writer—within a cultural environment stamped by the features of the early twentieth-century Budapest. In fact, his first literary takes (between 1907 and 1909) should be related to German and Hungarian languages, whose perfect command is proven through the writer’s extensive readings from the two literatures. Also, young Rebreanu had a close relationship with Hungarian writers; some of them became his collaborators, while others had been translated or imitated. His reinvention as a “national writer” implied thus to re-define and repress this multilingual inheritance. Before he became a “major” writer of an emergent literature, Rebreanu had developed as a “minor” author (in Deleuze’s terms) within an environment marked by diglossia, by the overlapping of several literary cultures, and by their conflictual articulation. At the same time, his case illustrates the process of literary emergence coming after the decline of the Austro-Hungarian Monarchy, but also the mobilization of a state of hybridity, which was made possible by the very existence of this multinational aggregation.
Similar content being viewed by others
Avoid common mistakes on your manuscript.
La Monarchie dualiste et la formation des grands écrivains nationaux
C’est Pascale Casanova, dans son ouvrage de référence qui est La République mondiale des lettres, qui faisait remarquer qu’on ne peut pas apprendre les « lois » de la littérature autrement que dans les grands centres littéraires. Un espace central, « international », est indispensable à la constitution des espaces périphériques. Car ce qu’on appelle « littérature mondiale » n’est pas constituée par la réunion et l’accumulation des petites littératures, sinon par un processus inverse, de fondation infinie des nouvelles littératures à partir d’un nombre réduit de modèles centraux. « …Chaque espace national est le produit de la forme même du champ mondial » souligne Casanova, pour reprendre cette idée quelques lignes plus loin, dans une formulation développée :
Le pôle autonome mondial est donc essentiel à la constitution de l’espace tout entier, c’est-à-dire à sa « littérarisation » et à sa « dénationalisation » progressive : il sert de recours réel non seulement par les modèles théoriques et esthétiques qu’il peut fournir aux écrivains excentrés du monde entier, mais aussi par ses structures éditoriales et critiques qui soutiennent la fabrique réelle de la littérature universelle. Il n’y a pas de « miracle » de l’autonomie : toute œuvre venue d’un espace national peu doté, qui prétend au titre de littérature, n’existe qu’en relation avec les réseaux et la puissance consacrante des lieux les plus autonomes (Casanova 1999, p. 164).
En fait, Casanova vise deux phénomènes différents sous une seule bannière. Dans un sens restreint, la participation des centres littéraires à la constitution des espaces littéraires périphériques se réfère à la circulation des valeurs de la littérature « pure ». La dynamique de la « littérarisation » et de la « dénationalisation » vise l’émergence de certains espaces privilégiés au sein des littératures nationales, qui ne se revendiquent plus de l’agenda politique d’une culture petite, mais du projet exclusivement littéraire d’une culture centrale. Dans un sens large, l’action des centres littéraires internationaux concerne le côté institutionnel de la production littéraire, le transfert des ressorts et des moyens qui soutiennent la création, la reconnaissance et la consommation de littérature. C’est ce que la chercheuse italienne appelle « la fabrique réelle de la littérature universelle ». Il s’agit des ressources éditoriales disponibles pour la publication des œuvres et pour la promotion des auteurs, de la rentabilité du circuit économique qui permet la monétisation des investissements créatifs, de la crédibilité des instances de reconnaissance et de consécration. Pour résumer, une littérature prestigieuse peut « emprunter » à une littérature émergente soit son dévouement gratuit pour l’esthétique, afin de délimiter une zone étroite, autonome, dans la culture publique d’une époque, soit sa machine littéraire parfaitement réglée, qui donne la possibilité à une grande population d’écrivains, de critiques et d’éditeurs de vivre de leur métier.
La démonstration de Casanova tend à privilégier le premier sens, à savoir la constitution d’une enclave autonome, dédiée à la « littérature pure » dans le cadre d’une culture périphérique. Elle met en évidence les tensions entre le pôle autonome et le pôle hétéronome, entre les écrivains qui orientent leur activité en fonction des modes littéraires d’une grande capitale culturelle (comme le symbolisme ou le naturalisme) et les autres, qui mettent leur littérature au service des projets nationalistes locaux. Cette perspective est étroitement déterminée par les choix qui appuient la réflexion de Casanova : tout d’abord, par l’intervalle temporel qui encadre son modèle d’interaction des cultures littéraires et qui correspond à l’établissement du prestige international de la culture française jusqu’au XIXe siècle ; ensuite par la focalisation presque exclusive sur Paris, comme centre de prédilection et modèle de tout autre centre de la littérature. Cela favorise une représentation des petites cultures au moment de leur émergence, dans leur lutte politique et nationaliste pour la reconnaissance (Casanova 2011, pp. 9–33), et du centre dans son émancipation radicale et son attachement exclusif pour les enjeux esthétiques de la littérature. C’est cet écart maximal entre culture périphérique et culture centrale, ce décalage radical entre leur « âge » et leur agenda, qui justifie en tant que thème principal de cette démarche la constitution des parcelles de « littérature pure » dans les espaces émergents.
En revanche, la situation de la Monarchie dualiste nous permet d’observer le deuxième processus, celui par lequel on transfère vers les petites cultures nationales les institutions vouées à appuyer le développement de la productivité littéraire. Les centres de l’Empire austro-hongrois, Vienne, Prague, Budapest, diffèrent de Paris à la fois par leur inscription historique et par leur rapport « géopolitique » spécifique avec les littératures nationales. Du point de vue de la chronologie, la Monarchie dualiste et sa dissolution interviennent dans une étape ultérieure à la fondation romantique des littératures et correspondent à l’explosion des courants modernistes et à leur conscience critique (Neubauer 2010, pp. 11–12). Au début du XXe siècle, la distance entre les « centres » et les « périphéries » n’est plus mesurée par l’écart entre le projet exclusivement nationaliste des petites cultures et le projet exclusivement autonome des cultures cosmopolites. En plus, la réalité multinationale de l’état austro-hongrois implique de facto une représentation des nations dans les grandes villes de la Monarchie dualiste. A la différence de Paris, qui favorise les conversions individuelles des auteurs provenus des petites littératures et qui accueille surtout des carrières d’immigrants (Casanova 1999, pp. 295–313), les grandes capitales de l’Empire comprennent des communautés ethniques qui fonctionnent comme des enclaves « à distance » des littératures nationales. On a d’ailleurs noté la proximité entre la culture de « capitale » et la culture nationaliste des groupes ethniques (Neubauer and Szegedy-Maszák 2006, pp. 162–175). Loin de reproduire la distance qui sépare Paris des foyers des littératures nationales, les centres de la Monarchie dualiste illustrent la cohabitation. L’assimilation des auteurs provenant des minorités ethniquesFootnote 1 ou la facilité des contacts entre les cultures littéraires petites en sont les manifestations les plus évidentes. Les littératures nationales sont là, au cœur des métropoles de l’Empire, peuplant les faubourgs, occupant les salles de théâtre, soutenant les revues. Les grandes villes de l’Empire austro-hongrois ne sont pas seulement les hauts lieux du cosmopolitisme, ils sont aussi un terrain privilégié d’observation et de communication avec les littératures nationales. L’exemple le plus significatif est celui de Kafka. Fasciné par la littérature tchèque et juive de Prague, il laisse dans la page de journal du 25 décembre 1911 la fiche de constat la plus attentive de ce que c’est qu’une littérature nationale (Casanova 1999, pp. 287–295). En même temps, il est un écrivain allemand, situé, par son amitié avec Max Brod, dans l’intimité de la « fabrique littéraire » d’une grande culture littéraire. Il a l’obsession des instances de reconnaissance, il est préoccupé de sa relation avec les éditeurs de succès, il vit dans la société des auteurs contemporains à œuvre importante (Lahire 2010, pp. 283–288). Sa condition « mineure » qui a inspiré Deleuze and Guattari (1975) ne désigne pas son ancrage exclusif dans une littérature nationale, sinon son accès simultané à deux cultures, centrale et périphérique, son partage d’intimité bidirectionnel, cette perspective double, et également rapprochée, sur le mode majeur et le mode mineur des cultures littéraires.
L’étude que je propose concerne l’activité d’un écrivain roumain, Liviu Rebreanu (1885–1944), formé dans la culture hongroise et allemande, agissant comme un auteur marginal dans les milieux littéraires de Budapest entre 1905 et 1909 et devenu un auteur majeur et un symbole national après 1920 dans la littérature roumaine. Sans être typique, ce cas permet l’observation de ce phénomène de transfert des ressources entre une culture littéraire centrale et cosmopolite et une culture nationale. Du point de vue sociologique, Liviu Rebreanu s’inscrit dans les circuits commerciaux de la littérature hongroise du début de siècle. Ecrivain provenant des écoles d’officiers de l’Empire,Footnote 2 il agit en dilettante, proposant des textes aux grands journaux et aux théâtres (Gheran 1986, pp. 155–156)Footnote 3: sans appartenir à un groupement littéraire, sans assumer les enjeux de l’élite littéraire contemporaine, il est en contact avec le milieu éditorial, il a une bonne perception du circuit économique qui rentabilise l’activité littéraire et aussi une notion du succès. Les auteurs qu’il fréquente ou qu’il prend en tant que modèlesFootnote 4 sont ceux qui combinent l’activité littéraire et l’activité journalistique ou qui profitent de l’engouement du public pour le théâtre afin de gagner leur vie. Les genres qu’il cultive à cette époque-là, la prose courte et les mélodrames, correspondent directement à ce type d’engagement littéraire. Ce qu’il apprend à Budapest est un modèle d’action littéraire, orienté vers la productivité littéraire, vers la rentabilité économique et vers la reconnaissance symbolique.
C’est notamment cette expérience qu’il transfère en Roumanie, immédiatement après 1909. A la différence de la plupart des Roumains qui vivent dans l’Empire et qui assument leur identité nationale, il ne se dirige pas vers la Transylvanie, mais vers Bucarest, la capitale, essayant de refaire en Roumanie son mode de vie de Budapest. La justification en est directement liée aux opportunités de la carrière littéraire : la capitale est le lieu de concentration des ressources littéraires. Il entre en contact avec les autorités critiques de l’époque, il cherche la collaboration avec les revues littéraires les plus influentes, tout en assurant son existence par des rubriques permanentes dans les pages des journaux commerciaux.Footnote 5 En tant qu’auteur, il choisit de s’orienter vers le genre à la mode, le roman, et pratique avec conviction la productivité littéraire, dont il fera souvent l’apologie :
…le vrai écrivain grand est celui doué par Dieu avec la capacité de produire beaucoup. Il n’y a pas de grand écrivain avec un volume ou deux. Des auteurs stériles qui s’efforcent toute leur vie pour griffer quelques pages, même s’ils ont du talent, restent de simples dilettantes… d’ailleurs les stylistes qui sont vraiment des créateurs sont toujours des féconds (Rebreanu 1968, pp. I, LXXIV).
Dix ans plus tard, lorsqu’il sera reconnu dans la littérature roumaine, il se définit par sa « grandeur », étant à la fois un écrivain profondément attaché au milieu professionnel, à la tête des structures institutionnelles qui dominent le champ littéraire roumain,Footnote 6 et un écrivain avec une œuvre vaste du point de vue quantitatif et variée du point de vue des sujets. En fait, Liviu Rebreanu inaugure pour la littérature roumaine la figure et la création « majeure », dans le sens de T.S. Eliot (1946) : massive, avec la conscience de la diversité des modes et des conventions, réalisée dans le cadre d’une carrière d’écrivain, et doublée par un engagement professionnel et public d’envergure. Une création qui se nourrit de sa systématicité et de sa productivité et dont il faut lire intégralement l’œuvre afin d’apprécier chacune de ses parties. En termes de « grandeur » (Schlanger 2008, pp. 110–119), Rebreanu représente ainsi une étape ultérieure à celle du « grand poète national », caractérisé par sa capacité d’articuler une narration identitaire, de projeter un mythe unificateur et d’exercer une activité d’écriture « prophétique », intermittente et fragmentaire (Nemoianu 2002, pp. 249–255 ; Neubauer 2010, pp. 12–13 ; Leerssen 2017).
C’est en cela que consiste mon interrogation : comment la Monarchie dualiste a participé à la constitution d’un régime « majeur » de la création dans les cultures nationales ? Ce qui m’intéresse est comment l’univers de représentations du romancier « majeur » puise dans les conventions du prosateur et du dramaturge « mineur », la mesure dans laquelle les thèmes de l’un retentissent et participent à la recette de succès de l’autre. Sans prétendre évoquer par le cas de Liviu Rebreanu la classe des auteurs « grands » dans l’Europe Centrale et de l’Est, j’entends explorer par ses singularités quelques-unes des particularités d’un tel transfert des pratiques, des valeurs et des savoirs littéraires. Entre le cosmopolitisme des centres culturaux de l’Empire et le nationalisme des petites littératures il y a un rapport constitutif, souvent ignoré. Bien entendu, cela implique une articulation entre la culture impériale et la culture nationale, difficile par ses enjeux, niée par la logique même de constitution du mythe national. Se demander de quelle manière un centre culturel de la Monarchie dualiste a pu contribuer à l’apparition d’un « grand écrivain » national revient à une réflexion sur les ressources subtiles et hétérogènes de l’univers des représentations nationalistes. Comment l’expérience littéraire menée dans le contexte de l’Empire a été reconduite dans une grande carrière nationale ? Et surtout comment ses valeurs cosmopolites ont été réinvesties dans le circuit des valeurs de la vie nationale ?
Une « Vita nova » : la transfiguration d’un écrivain mineur
J’ai dû comprendre que je ne pourrais pas être écrivain roumain tant que je serais forcé de communiquer dans un milieu étranger, de parler et de réfléchir dans des langues étrangères. J’ai passé dans des écoles étrangères plus de deux tiers de mes années de formation. […] Mes tentatives littéraires, biens qu’éprouvées dans une âme roumaine, étaient méditées dans une langue étrangère, soit allemand, soit hongrois, avant de les transcrire en roumain. J’ai dû me rendre compte que, si je veux réaliser quelque chose, il faut préalablement détruire dans mon âme et dans ma pensée, tout ce que des années passées dans le milieu étranger y ont imprimé, notamment à l’âge le plus ouvert envers toutes les influences (Rebreanu 1984, pp. 302).
Liviu Rebreanu donne ce témoignage en 1939, au moment où le succès de l’écrivain était largement reconnu. Ce n’est qu’un des nombreux aveux qui évoquent sa séparation des années de formation littéraire hongroise et allemande. L’écrivain construit l’image d’une victime de l’histoire, déchirée entre âme et raison, entre l’attachement affectif pour la langue roumaine et la contrainte des langues étrangères. Dans ce scénario, il n’y a qu’un seul sens du rapport aux langues et à la littérature, qui va de l’étranger au propre, de la contrainte au choix libre, de l’extériorité institutionnelle à l’intériorité affective. En effet, près de trente ans après son expérience de Budapest, Liviu Rebreanu élabore un mythe polaire qui oppose radicalement, sans continuation possible, l’apprentissage dans les grandes littératures de l’Empire et l’action dans la littérature nationale. Il s’agit d’une évolution par rupture : l’écrivain qui choisit la littérature roumaine, loin de profiter de ses expériences hongroises, est censé les oublier ou les effacer : « On respirait la culture étrangère malgré soi, une fois avec l’air, diffusée partout. Il n’y avait, contre cette présence, qu’une seule solution de sauvegarde : le refuge dans un autre milieu, avec une autre atmosphère, sous l’emprise d’une autre culture » (Rebreanu 1984, pp. 302). En fait, ces témoignages font partie d’une justification, souvent reprise, de la nécessité de réinvention de soi dans le cadre de la littérature nationale. Nous assistons à l’histoire d’une conversion, à la découverte d’une « vita nova ». Ce que Liviu Rebreanu décrit c’est la révélation, éprouvée soudainement, de son aliénation par rapport à son peuple, à la langue et à la littérature nationale : « Un jour j’ai compris l’hybridité de cette littérature internationale. Je dirais que cela fut ma petite crise sur la route de Damas, lorsque j’ai réalisé que dans tout ce que j’avais écrit jusque-là il m’avait manqué la prise sur la terre » (Rebreanu 1984, pp. 388).
A voir de plus près, les axes qui articulent ce mythe d’ « une nouvelle vie » sont étroitement liées au prestige des cultures littéraires de la Monarchie dualiste. Ce n’est pas par hasard que les témoignages de Rebreanu tendent à souligner la connotation « littéraire » de ces langues étrangères. « J’étais dans les classes de gymnase, j’avais appris l’allemand et le hongrois et j’écrivais dans ces langues-là, parce que j’avais l’impression que mon roumain, ‘de ma mère’, étais trop peu littéraire » (Gheran 1986, pp. 140). Qu’est-ce qu’il veut dire par « littéraire » est, de point de vue des pratiques, plusieurs choses. C’est la langue inscrite dans une convention, utilisée communément par une classe d’écrivains et des publications, qui correspond au goût d’une certaine société et à son caractère éphémère. L’écrivain déclare dans une interview de 1935 : « à l’époque, c’était la mode des nouvelles de salon, publiées dans les journaux pour le divertissement du public, et j’en étais influencé » (Rebreanu 1988, pp. 140). La « mode » illustre de manière assez fidèle—mais évidemment péjorative—l’activité de jeune Rebreanu à Budapest. Il s’agit d’une littérature à fonction de divertissement et facile, mais directement dépendante des structures sociales et commerciales qui assurent à la fois sa productivité et sa rentabilité : lien étroit avec une classe sociale, accueil dans les journaux généraux de grand tirage, recette qui permet la production sérielle des textes. En fait, le mythe distribue d’une part une « machine littéraire », collective, conventionnelle et institutionnalisée, et de l’autre l’effort individuel de transcription du réel, la lutte corps-à-corps avec la langue et avec ses ressources primaires : « Pendant mon adolescence j’étais mois-aussi très fécond. Dès que je suis arrivé à Bucarest et que j’ai compris mon rôle parmi les écrivains, j’étais conquis par le respect et par la timidité devant le mot écrit […]. C’est d’ici que provient la difficulté de ma prose » (Rebreanu 1968, pp. I, LXXX).
Ces aveux autobiographiques sont complétés par des mises en scènes fictionnelles qui participent à la construction du même mythe d’une réinvention de soi dans la culture roumaine. Les biographes de Rebreanu ont reconnu dans un des personnages qui traverse la plupart de ses romans, Ion (1920), Răscoala (1933), Gorila (1936) une représentation autobiographique du jeune écrivain qui arrive en Roumanie après avoir fait ses expériences dans la Monarchie dualiste (Gheran 1986, pp. 201–204). Sauf que, dans la cadre du récit de fiction, l’ancien écrivain transylvain apparaît dans l’hypostase du poète, mobilisant le cliché romantique du génie (pauvre, incompris, en décalage avec sa société, isolé, voire ridicule) : « Je suis convaincu que j’aie du talent… Oui, j’ai pensé souvent que je suis un poète génial. Qui sait !? C’est bien possible que je le sois. Mais je n’ai pas eu de la chance dans ma vie. Mon nom n’a circulé que dans ce cercle trop étroit qui s’appelle ‘le monde littéraire et artistique’ » (Rebreanu 1986, pp. III, 767). Evidemment, entre le poète évoqué dans les textes de fiction et l’écrivain « à la mode » illustré par les textes autobiographiques il y a des différences très importantes. Le poète n’est pas bien intégré dans une société, il atteint un public plutôt restreint, il n’arrive pas à publier dans la presse généraliste, il ne participe pas à une culture de la consommation. Loin de la rentabilité économique assurée par la « mode », il est plutôt détaché de toute considération matérielle. Rebreanu ne manque pas de souligner cette particularité :
…lorsque la revue Familia a publié une poésie de trois strophes, il s’est décidé définitivement, mais secrètement : il sera poète. Ses sœurs le regardaient comme un homme important et les parents partageaient l’opinion des filles, bien qu’ils eussent de la peine à comprendre comment Titu puisse se nourrir et s’habiller de ses poésies […]. Très tôt, toute la commune l’a consacré poète. Et Titu lisait et écrivait très tard dans la nuit ; il éteignait la lampe, il attendait l’inspiration dans l’obscurité, il esquissait quelque vers dans sa tête, il allumait la lampe et il l’éternisait sur la feuille de papier… (Rebreanu 1986, pp. I, 61).
S’il choisit de réinterpréter dans un registre romantique son activité d’écrivain de la Monarchie dualiste, c’est qu’elle souligne avec force le détachement et l’isolement par rapport à la société. En fait, la figure du poète bohème est à l’origine au processus d’autonomisation du champ artistique au XIXe siècle (Heinich 2005, pp. 27–130) et par ses thèmes représente l’ordre différencié de la littérature. L’œuvre conduite par l’inspiration, l’absence de la récompense matérielle, la gratuité de l’effort créateur illustrent une culture distincte qui n’a rien à voir avec la réalité quotidienne. La figure du poète mesure la distance de l’écrivain par rapport à son milieu social et au monde. C’est ce que découvre le personnage-poète dans le roman Ion : « à quoi bon écrire des poèmes lorsque son âme était glacée par indifférence ? A qui servait le fait qu’il lisait tous les livres qu’il trouvait, en remplissant sa mémoire avec les pensées des autres, sans chercher à connaître ce qui l’entourait ? Pourquoi imaginer des drames et des tragédies pour sa propre gloire lorsqu’on contemple la tragédie d’un peuple entier, plus impressionnante, parce que muette, que toute fantaisie romantique ? » (Rebreanu 1986, pp. I, 223). En même temps, le recours à cette figure éclaircit les enjeux du mythe construit par l’écrivain. Par le cliché du poète romantique, Rebreanu mobilise une opposition radicale entre la littérature et la vie. C’est une évocation de la littérature comme sphère d’activité inauthentique, dépourvue de prise au réel qui distribue, d’une part, les praticiens d’un métier ésotérique et sans contact avec le monde, et de l’autre les écrivains qui documentent l’état des choses, en se confrontant directement avec l’existence, sans la médiation des conventions littéraires. Le thème de la supériorité de la vie par rapport à la connaissance fournie par les livres (Gheran 1986, pp. 214) constituera finalement l’articulation fondamentale de cette mythologie de la séparation et de la répression du multilinguisme.
Il ne faut pourtant pas ignorer le caractère circonstanciel de ces représentations. En fait, si on cherche les origines de l’évocation du l’écrivain « poète », on doit remonter jusqu’à 1919. C’est à la fin de la Première Guerre Mondiale que cette image apparaît pour la première fois, dans des conditions biographiques très particulières : après avoir été accusé de trahison par les autorités roumaines, en guise de justification publique dans un contexte de contestation de sa réputation, l’auteur construit une représentation de soi qui engage une figure de la séparation radicale par rapport au milieu étranger. Le premier texte qui véhicule cette mythologie s’appelle Calvarul [Le Calvaire] et raconte, sous la forme d’une autofiction, l’épisode de la double persécution du jeune écrivain, par les autorités roumaines et par les autorités allemandes. L’écrivain a dû comprendre que son intégration dans la littérature roumaine impliquait la dénonciation de son héritage multiculturel et littéraire. Son attachement pour les enjeux de la nation allait de pair avec son engagement contre la « littérature »—c’est-à-dire avec la représentation d’une littérature émanée directement de la « vie » et présentée comme document, dépourvue d’institutions, de codes génériques et décuplée des rythmes de la mode. L’apparition d’un mythe de séparation s’avère ainsi une nécessité politique, dont la vocation était de camoufler et déformer profondément la réalité des pratiques d’écriture.
Techniques de transfert
Si on regarde l’œuvre publiée, les textes manuscrits et les ébauches qui correspondent au début de Liviu Rebreanu et à son passage en Roumanie, soit l’intervalle compris entre 1907 et 1919, ce qu’on voit est le travail soutenu de reprise. Loin de constater la rupture entre les deux expériences littéraires et la mutation fondamentale du registre de la création—la réorientation des « livres » vers la « vie », ou de la littérature vers le document— ce qu’on voit relève plutôt de l’ordre de la continuation. En effet, l’édition des archives de l’écrivainFootnote 7 a mis en évidence un large processus de transformation et de recyclage qui engage pleinement l’expérience littéraire hongroise dans la production des textes roumains. C’est le rendement de l’écriture qui explique ce travail de reprise. En raison d’un principe de l’économie, l’écrivain qui est en train de s’orienter dans un nouveau milieu social et littéraire s’apprête à composer une œuvre des éléments empruntés à ses propres textes et aux littératures dont il est déjà familier, hongroise ou allemande. Il n’invente pas entièrement sa littérature, tout en abandonnant ses tentatives antérieures : le passage vers la littérature roumaine est réalisé par un attentif montage des situations, des passions et des rapports qu’il connaît déjà, de son expérience d’auteur ou de lecteur. Pour saisir ces gestes de reprise, je distinguerais entre deux pratiques.
La première, que j’appellerai de « traduction », implique une sélection des textes appropriés à la description de la réalité roumaine. L’écrivain cherche, dans sa propre production littéraire ou dans les œuvres des auteurs hongrois ou allemands qu’il connaît, des modèles capables de représenter le matériel qu’il rencontre lors de son passage en Roumanie. Qu’est-ce que c’est que le matériel roumain ? Des situations sociales, des drames ou des préoccupations spécifiquement locaux. En l’occurrence, il s’agit des moyens littéraires destinés à la représentation de la vie rurale et de ses passions économiques, sociales ou érotiques. Le jeune Rebreanu puise dans les littératures étrangères des modèles de discours plausibles pour les formes particulières d’existence sociale de la réalité roumaine. Il a la tendance de constituer une « bibliothèque » adaptée aux sujets qu’il veut traiter dans son nouvel espace littéraire. Par exemple, il traduit de la littérature hongroise une prose de Mikszáth Kálmán, Ţăranul şi coasa [Le paysan et la faux],Footnote 8 qui décrit dans un registre réaliste une négociation menée pour l’acquisition d’une faux. Bien entendu, il n’est pas question de la singularité irréductible du phénomène roumain, sinon d’une quête des sous-genres qui correspondent dans les littératures étrangères au régime de vie rurale.
La deuxième pratique, que j’appellerai d’ « équivalence », entraîne un travail d’adaptation des textes à la réalité roumaine. En fonction du principe de l’économie déjà mentionné, l’écrivain ajuste des situations ou des personnages de ses œuvres en hongrois, par des changements progressifs, en sorte qu’elles soient acceptables dans le contexte culturel roumain. Pratique fréquente parmi les exercices qui accompagnent le passage de Rebreanu dans la littérature roumaine, elle s’impose par sa productivité. Par l’ « équivalence », Rebreanu identifie le nombre minimal des transformations du matériel étranger nécessaire à sa conversion en matériel local. C’est un procédé symétrique à celui de « traduction ». Au lieu de chercher dans la littérature étrangère des genres déjà adaptés à la réalité roumaine, il expérimente des transplantations, essayant de ré-calibrer des genres indifférents en fonction des contextes nationaux. Par exemple, à la fin de 1908, très tôt après son arrivée en Roumanie, Rebreanu essaye de convertir une prose courte, Domnul Ionică [Monsieur Ionică], tirée d’un recueil en hongrois inspiré de la vie des militaires de l’armée impériale : il change les noms des personnages et la tonalité de l’évocation pour voir si l’histoire de la déception amoureuse d’un officier supérieur peut être transposée dans la culture roumaine contemporaine. La même année, on constate dans ses cahiers des exercices similaires d’adaptation d’un drame bourgeois, Ghighi, censé décrire les mœurs de la société hongroise de province (Rebreanu 1968, pp. II, 1158–1172 ; Gheran 1986, pp. 210–213). L’écrivain commence par opérer des petites modifications (concernant le nom des personnages ou leur profession), tout en continuant avec la définition des rapports sociaux, pour transférer le conflit du drame bourgeois dans le cadre de la société roumaine rurale. Au cœur de ce travail de déplacement se trouve un questionnement implicite sur les limites de la réalité, pour éprouver son élasticité envers des modes de vie qui ne lui sont propres. Ou, plus précisément, pour cerner la « vérité » de ces modes de vie, c’est-à-dire leur capacité d’adaptation et d’intelligibilité dans une nouvelle situation locale.
Ce qui me semble notable est le fait que ces pratiques de reprise concernent l’adaptation d’une forme dans le sens très large, comme forme des rapports humains significatifs pour le conflit dramatique ou pour l’intrigue. Par les changements qu’il opère, souvent minimales, l’écrivain transfère dans l’espace roumain des mécanismes affectifs : l’acharnement d’un paysan qui veut acheter à bon prix un outil, la déception amoureuse d’un officier, la frustration d’une fille qui cherche un mariage avantageux. Ce que Rebreanu récupère de son expérience hongroise sont des ressorts capables de soutenir le tissu narratif, des solutions pour dynamiser de point de vue dramatique les représentations de la réalité roumaine. Il est sans doute surprenant que ces importations participent directement à la figuration littéraire de l’existence nationale, à la description de la conduite paysanne ou des sentiments ruraux ; il est également surprenant que ce travail de transfert arrive à mettre en question la représentation de la réalité roumaine, les limites de sa gamme de sentiments et de conflits. Autrement dit, il est surprenant que l’écrivain ait pensé forger sa « littérature roumaine » dans une forme étrangère, sinon dans ses thèmes, au moins dans ses ressorts dramatiques. Car de la sorte il mobilise directement les littératures cosmopolites qu’il connaît dans la construction de « vie » locale. Ce que nous constatons ici, dans les premiers ans de formation de Rebreanu est, au-delà de la simple justification « économique » qui impose la conversion des textes hongroises, la naissance d’une poétique qui consiste dans la réinterprétation du matériel national à travers des codes et des mécanismes émotionnels étrangers, déjà essayés.
Recyclage des émotions : la honte
Je vais illustrer cette hypothèse par l’examen des figures et des récurrences de la honte, émotion qui traverse à la fois la littérature en hongrois de Liviu Rebreanu et sa littérature roumaine. La honte, qui a fait l’objet de nombreuses recherches (Deluermoz et al. 2013), est une passion « institutionnalisée » dans la modernité (Lordon 2014, pp. 91), c’est-à-dire une passion qui fait l’objet des pratiques collectives, assumées et codifiées par le discours public, promues parfois par la propagande et par les politiques officielles. L’explication la plus simple de l’importance publique et commune de cet affect privé se trouve dans la rhétorique d’Aristote (2004, pp. 1384), qui inclut la honte dans la série des passions vouées à « mouvoir les âmes des interlocuteurs ». Sa fonction collective dérive de sa capacité de mobiliser et de pousser à l’action, car au nom de l’honneur et de l’humilité, la société peut être engagée à la défense des causes publiques (Patriarca 2012, pp. 74–81). Au XIXe siècle, on a distingué deux usages sociaux de la honte, qui s’expriment par deux types d’institutionnalisation et par deux configurations culturelles parallèles : une qui est orientée vers la défense du corps de la nation, l’autre qui vise le corps de l’état. Tout d’abord, la honte fonctionne dans la tradition absolutiste en rapport direct à la personne du prince, qui incarne l’autorité de l’état. A travers la hiérarchie militaire et les codes de l’honneur inscrites dans la structure des classes sociales, la honte agit comme un mécanisme qui assure la fidélité par rapport à la monarchie. C’est ce qui soutient, par exemple, la mobilisation en conditions de guerre : il est bien connu l’usage de la honte par la propagande pendant la Première ou la Deuxième Guerre Mondiale (Frevert 2011, pp. 32–33). C’est après la Révolution française et surtout pendant les révolutions nationalistes de XIXe siècle, que cet affect acquiert une deuxième fonction sociale (Frevert 2011, pp. 68–80). La honte n’est plus éprouvée envers la personne du prince ou de l’empereur, par l’intermédiaire des codes de l’honneur, sinon envers la nation en son entier. Par le déplacement métaphorique entre l’honneur de famille et l’honneur patriotique et par la sexualisation du corps national (soutenue par les allégories féminines de la patrie), la honte commence à fonctionner dans le cadre d’une politique nationaliste (Patriarca 2012, pp. 74–78). Dans ce deuxième scénario, la honte ne fait plus appel à l’honneur d’une classe sociale ou d’une hiérarchie, sinon au sentiment masculin envers la vulnérabilité de l’être aimé : l’atteinte à l’honneur s’impose de manière directe, sans la médiation d’une classe ou d’un statut social. Il s’agit d’une « démocratisation » de l’honneur (Patriarca 2012, pp. 72) qui a été exploitée par la plupart des initiatives nationalistes au XIXe siècle.
De ce point de vue, la honte est loin d’être une passion neutre : ses thèmes et sa disposition reflètent directement le type d’engagement d’une culture littéraire. Si les traditions de la culture roumaine, forgées dans l’esprit de la révolution nationaliste du XIXe siècle, codifient surtout la honte patriotique, jouant sur la confusion entre la famille et la nation, la culture hongroise au début du XXe siècle est bien plus enclin à figurer par la honte une passion de l’honneur bourgeoise et de la fierté impériale.
La honte est au cœur du premier recueil de Liviu Rebreanu, Scara măgarilor—Szamárlétra [L’échelle des ânes] écrit intégralement en hongrois entre 1907 et 1908. Inspirées par la vie des militaires dans la Monarchie dualiste, les proses qui composent le volume mettent en scène la honte et ses corrélats—l’honneur et l’humilité—pour illustrer le souci de la réputation. Ce qu’il faut souligner est l’importance de cette gamme émotionnelle dans l’économie dramatique des textes : la honte, comme passion envers l’autorité militaire et, par extension, envers l’autorité politique de l’empereur, soutient le déroulement de la narration et constitue le ressort principal du conflit. Le lieutenant, qui est victime d’une circonstance entraînant la perte d’une grande somme d’argent, décide de se suicider par « la honte » de ne pas être emprisonné « devant la monarchie toute entière ». C’est ce qui soulignent impitoyablement ses camarades : « Il va se suicider ! Il n’a pas d’autre sortie. S’il ne veut pas qu’on l’emprisonne devant la monarchie toute entière pour vol » (Rebreanu 1968, pp. I, 294). Dans un autre texte, le soldat éprouve de la honte par rapport au général. « C’est pour ça que je t’ai envoyé chez Monsieur le Général ? Toi… ingrat… tu payes ma bienveillance par des conneries… en révoltant par ta conduite Monsieur le Général, Madame et toute la Famille ?… » (Rebreanu 1968, pp. I, 94). L’écrivain accorde une attention particulière à la description de cette émotion vécue devant la communauté des militaires : « Il n’y avait personne qui adresse la parole à Kerekes. Si on lui parlait, ce n’était que pour l’humilier… C’était pour la première fois que András éprouvait le besoin d’un vrai camarade, capable de compassion… Maintenant, lorsque tous l’avaient abandonné, la honte tendait vers lui des bras froids, de reptile… » (Rebreanu 1968, pp. I, 95). Je citerais dans cet ordre encore une prose, Le cadet. Presque sans motivation extérieure, le protagoniste perçoit le caractère incontrôlable et extérieur de sa réputation. Il n’est pas la victime d’un accident ou d’une circonstance malheureuse, mais tout simplement de la chute de sa cote auprès des officiers supérieurs : « Il est certain qu’il ait été complètement ridicule. Il n’a pas été capable de dire quoi que ce soit. Uf ! Il ne voulait plus s’en rappeler, il voulait disparaître par honte » (Rebreanu 1968, pp. I, 211). En directe proportion avec son impuissance à comprendre ce qui lui arrive, il éprouve la force de l’émotion qui le pousse, lui aussi, vers le suicide. « Chaque fois que le cadet Szilly faisait une bêtise, il se rappelait les mots du colonel : … Il sentait que quelque chose l’étrangle, arrête son souffle, l’aveugle » (Rebreanu 1968, pp. I, 214).
Ce qu’on voit ici c’est une émotion définie par la situation de la culture impériale : par le rapport à la hiérarchie et à ses positions supérieures, comme forme du respect pour l’ordre de l’état et de la société, comme expression corrélative de l’honneur d’une communauté déterminée (la classe des militaires ou la classe bourgeoise). Or, force est de constater que l’écrivain transfère la honte exactement dans cette configuration dans ses premiers textes roumains. L’affect est évoqué dans les proses de Rebreanu en roumain, qui datent de 1908, comme une adaptation directe de la représentation hongroise. Dans Glasul inimii [La voix de l’âme], sa première prose écrite et publiée en roumain, il s’agit toujours de la honte envers l’empereur, des rapports d’honneur envers l’autorité et l’état dans le milieu militaire. La raison de la passion coupable est la désertion de l’armée impériale. L’adéquation au matériel local impose, en raison du principe de l’économie que nous avons déjà constaté, que l’écrivain opère pourtant une modification du rang. Les paysans roumains qui éprouvent de la honte sont des soldats dans l’armée de la Monarchie, et non pas des officiers ou des cadets : « Je me rends compte qu’il se rappelle ses fils et qu’il en a honte. Codrea a eu sept fils, sa fierté. Et tous les sept l’ont humilié, ont déserté de l’armée, comme s’ils l’avaient fait express » (Rebreanu 1968, pp. I, 7).
Le thème de la honte articule aussi l’univers bourgeois dans Ghighi (1908), le premier drame manuscrit où Rebreanu emploie en alternance le roumain et le hongrois. Son sujet est celui du statut d’une famille qui veut être acceptée dans une classe qui est au-dessous de ses moyens économiques. La préoccupation pour la réputation, éprouvée dans le cadre d’une société hiérarchisée, en fonction des définitions strictes de l’honneur de classe, oriente l’usage de la figure émotionnelle : il est honteux précisément ce qui ne correspond pas au niveau social désiré. Avoir des prétendants, se conduire d’une manière libertine, travailler—toutes ces conduites sont appréciées en fonction d’une notion de la réputation strictement liée aux pratiques acceptables de la classe bourgeoise. La protagoniste se rapporte aux normes de sa catégorie sociale pour apprécier la valeur de ses propres comportements : « Tu sais qu’est-ce qu’être une demoiselle ! Pour une demoiselle le travail n’est pas une raison de fierté » (Rebreanu 1980, pp. XI, 579). Symétriquement, sa mère lui rappelle le changement des mœurs en ce qui concerne la honte ou la fierté, mais seulement pour renforcer la perception des codes sociaux : « On disait qu’il ne convient pas de faire de telles choses, que la fille perd ainsi son honneur. Parce qu’à l’époque, on appréciait que l’honneur d’une fille consiste dans sa vertu, et sa vertu, dans sa pureté… » (Rebreanu 1980, pp. XI, 578). Les séquences en roumain de ce drame sont obtenues par une transposition des mêmes conflits dans le milieu roumain. Comme dans le cas de l’honneur militaire, Rebreanu déplace l’émotion dans l’espace roumain, réinterprétant une passion locale et rurale par la reprise des tensions et des enjeux d’un affect bourgeois. Cette recette est employée dans un autre texte qui date de la même époque, Ofilire [Etiolement]. Rebreanu y opère un transfert de la honte dans le milieu rural pour essayer, pour la première fois, la mécanique du conflit fondé sur la réputation dans le cadre d’une société traditionnelle. La nouvelle évoque le drame d’une fille qui reste enceinte par le fils du rentier la région. Tous les avertissements qui pressentent le dénouement tragique sont construites autour de la constellation négative de la honte : « ne me fais pas de la honte » (Rebreanu 1968, pp. I, 15) lui dit son père. Pour réagir un peu plus tard devant l’inévitable : « il a envie de s’écrier pour que tout le monde l’entende, que cela n’est pas possible, que cela est une honte terrible » (Rebreanu 1968, pp. I, 16).
Ce transfert du souci pour la réputation spécifique à une société bourgeoise dans un monde rural anticipe déjà le premier roman de Rebreanu, Ion (1920). La publication de l’esquisse du roman a montré que le premier fragment qui annonce le roman en 1917 (Gheran 1986, pp. 233–234 ; Gheran 1989, pp. 85) s’intitule Rușinea [La Honte], ainsi que le chapitre cinquième de la version finale du manuscrit. En effet, toute l’action du roman tourne autour de cette émotion. La honte est évoquée dès les premières pages du roman comme sentiment dominant et constitue le moteur du conflit, ainsi que le ressort de son dénouement tragique. Les personnages sont mobilisés presqu’exclusivement par cette passion, peu importe leur rôle, principal ou secondaire, dans le développement de l’action : le paysan pauvre, qui découvre son appétit insatiable pour la possession et pour l’amour, est conduit d’abord par le sentiment d’humilité par rapport au paysan riche, dont il envie la situation. Celui-ci est, à son tour, humilié par la défloraison de sa fille. Le prétendent est humilié par la fille qui le refuse, la fille est humiliée par le mari infidèle, les filles de l’enseignant du village sont humiliées par leur statut social etc. La honte est une source du drame si fréquente, qu’elle tend à s’incarner dans une présence presque matérielle, comme dans ce discours intérieur : « Une honte insupportable l’étranglait, mais ce n’était pas parce que sa fille était enceinte, sinon parce que George ne l’épouse pas… s’il l’avait déflorée. La honte le rendait fou lorsqu’il disait que si le gars ne fait pas son devoir, il devra lui-même aller discuter avec Toma, afin qu’on fasse le mariage avant la naissance de l’enfant, pour ne pas être obligé de subir la honte suprême [littéralement dans le texte roumain : « d’avaler la honte dans ses poignés »] ». Rebreanu reprend volontiers des situations de conflit basées sur la honte qu’il avait utilisé auparavant dans des drames ou dans des proses écrites en hongrois ou en roumain dans ses premières années d’activité littéraire. Aussi, l’émotion évoque-t-elle une société bien plus stratifiée que la communauté rurale illustrée dans le roman. Bien des situations rapportent directement la honte au statut social des personnages, à leurs aspirations de reconnaissance et s’appuient sur un souci explicite pour la réputation. La honte est éprouvée sous le regard des autres, « devant le monde tout entier », directement conditionnée par leur considération : « Tout le monde tourna la tête soudainement vers Ion, qui, sans oser bouger, abaissa les yeux tout en jaunissant et tremblant de honte, subissant le regard des autres qui le scrutaient » (Rebreanu 1986, pp. I, 76).
Enfin, la honte éprouvée par rapport à l’autorité de l’état et de l’empereur revient dans le deuxième grand roman écrit par Liviu Rebreanu après son arrivée en Roumanie, Pădurea spânzuraţilor [Le forêt des pendus, 1922]. Le roman, qui raconte l’histoire de la découverte du sentiment national d’un officier roumain enrôlé dans l’armée impériale, met en question les notions de l’état, du devoir ou de la patrie et leur capacité de mobiliser et d’orienter les individus. Comme dans le premier recueil de proses inspirées de la vie des militaires dans l’armée austro-hongroise, la honte, ainsi que l’humilité et l’honneur, se trouvent au cœur de cette analyse de l’attachement affectif pour les entités abstraites. Sauf que cette gamme d’émotions n’est plus le moteur du conflit, que l’objet d’un engagement réflexif de la fiction : si la honte y revient, c’est pour poser des problèmes intellectuels et des dilemmes. Trois ans après la disparition de la Monarchie dualiste, les personnages parlent des « ruines des émotions », de la faillite affective et de la « crise » des sentiments de respect envers l’autorité de l’état. C’est à un des personnages de donner voix à ce rapport à l’émotion : « L’amour a fait faillite, tout comme l’humilité, la soumission… L’homme veut maintenant être fier et maître et égoïste, il veut lutter et vaincre ses ennemis, quels qu’ils soient, où qu’ils soient… Aussi, devons-nous effacer les ruines de nos âmes et préparer l’arrivée du nouveau dieu, qui ne demande plus soumission et abaissement, sinon lutte et âme fort ! Jusqu’aujourd’hui nous avons eu honte de la haine de notre âme, bien qu’elle soit sœur avec l’amour… » (Rebreanu 1986, pp. I, 643). Même si le spectre des sentiments se dissocie, pour se dédoubler entre « la haine » contre l’état impérial, et « l’amour » pour l’état national, la honte reste pourtant unique, marquant le rapport du sujet avec la Monarchie. En fait, le roman n’analyse pas l’émergence d’une autre « honte », nationaliste et patriotique, sinon le processus de désagrégation de l’émotion absolutiste. L’évolution du protagoniste entraîne des mécanismes moraux de plus en plus puissants de défense contre les affects imposés par le respect des autorités impériales. On évoque son « sentiment fâcheux de honte » (Rebreanu 1986, pp. I, 705), tout comme on décrit sa résistance affective. La honte éprouvée devant le regard des autres n’y est plus le mobile irrépressible du drame, elle est un corps étranger, dont le protagoniste essaie de se débarrasser : « Apostol sentait tous les regards comme des flèches dans son cœur et recommença de balbutier ‘Mon Dieu… mon Dieu…’ comme une défense contre la honte lourde qui pesait sur son être » (Rebreanu 1986, pp. I, 704). Mais fondamentalement ce qu’il ressent est le déclin d’une émotion, et non pas son renouvellement. L’auteur évite toujours de mettre à la place de ce sentiment étranger un autre qui lui soit propre, de substituer la honte absolutiste par la honte nationaliste : il préfère analyser et tirer des effets dramatiques de la ruine de celle-là plutôt que du triomphe de celle-ci. Le roman raconte en fait l’histoire d’une « émotion perdue », selon le syntagme de Ute Frevert. Car même à ce moment, après l’installation en Roumanie et après la dissolution de la Monarchie dualiste, l’écrivain reste attaché à cette émotion dans sa définition absolutiste.
*
Au bout de cette analyse, on voit bien que la honte ne suit pas chez Rebreanu la filiation patriotique qu’on constate dans l’œuvre de bien d’écrivains roumains. Par contre, cette émotion apparaît chez Rebreanu comme une hypostase des sentiments envers la Monarchie dualiste, la hiérarchie et l’état, étroitement liée au sentiment d’appartenance à la classe bourgeoise. Ce n’est pas la sexualisation du patriotisme illustrée par les traditions littéraires du XIXe siècle, sinon un rapport bien plus complexe à l’autorité et à la société, avec des inflexions psychanalytiques.
On peut apprécier les conséquences de ce choix dans la définition et la perception publique de l’œuvre de Rebreanu. Le fait que la constellation émotionnelle de la honte se retrouve dans des fictions qu’il publie en Roumanie au début des années vingt contribue pleinement à sa « nouveauté » sur le marché littéraire national. En effet, Rebreanu applique aux paysans roumains la préoccupation bourgeoise pour la réputation et l’honneur. Il opère ainsi une « colonisation » affective du monde rural avec des émotions spécifiques à une autre société, bien plus raffinée. Par rapport à la littérature de l’époque ayant comme sujet le mode de vie paysanne, le changement est considérable : au lieu d’un monde rural qui mise sur le primitivisme et l’instinct, la honte engage un conflit intensément socialisé et intellectualisé. Ses rapports multiples avec les autres, avec les conventions sociales et avec la conscience de classe induisent dans la représentation de la communauté traditionnelle une complexité inédite. Ce n’est pas le seul contexte qui cerne la « nouveauté » de la recette de Rebreanu. Dans le cadre de l’évolution contemporaine de la prose roumaine, qui devient dans les années 30 urbaine, analytique et intimiste, paradoxalement, cette littérature alimentée par la honte a une vocation prospective. Elle réinterprète une société traditionnelle selon des normes de l’intériorité, empruntant à chaque personnage une détermination intime, quoique stéréotype, des actions. Si Rebreanu propose un roman rural et régional, il implique des émotions urbaines qui anticipent à peu près d’une décennie les explorations de l’intimité dans la littérature roumaine.
Mais le cas de l’émergence de cet écrivain majeur dans une littérature mineure nous permet de voir aussi un phénomène de transfert culturel méconnu. Ce que la honte met en évidence est une circulation des valeurs entre les centres littéraires et les périphéries qui ne relève plus de l’importation et de l’imitation de formes, mais d’une réalité plus subtile et plus hétérogène, qui entrecroise les formes, les institutions collectives et la « matière » des passions. Difficile de faire la différence, dans ce cas, à l’instar de Franco Moretti (2000, pp. 58–60), entre la « forme internationale » du roman et la « matière locale » des contenus qui y sont injectés. Autrement dit, difficile de faire la différence entre la forme étrangère empruntée et la substance autochtone de la vie nationale. Ici c’est notamment la matière—les émotions, les passions—qui fait l’objet d’un transfert de prestige entre le grand centre cosmopolite et la petite culture ethnique. La circulation transculturelle des affects est un processus singulier, à la fois par sa subtilité, par sa contribution au régime des « grandeurs » d’une littérature et—implicitement—par sa participation à la constitution de la norme nationale. Car par cette importation de « matière », c’est-à-dire des formes de la vie affective, on obtient une perspective sur les puissances étrangères qui modèlent la vie nationale et sa substance pathétique. Si Deleuze et Guattari, en s’appuyant sur la même proximité des cultures nationales et des cultures centrales dans l’Empire austro-hongrois, ont poursuivi la constitution d’un registre mineur, c’est-à-dire le déplacement des valeurs de la langue de culture dans la perspective de la politique nationaliste, ce qu’on peut observer dans la biographie créatrice de Liviu Rebreanu est le cas inverse : la constitution d’un registre majeur dans une petite culture, ayant la perspective de la centralité. Il s’agit toujours de la dislocation, des valeurs étrangères introduites secrètement dans le corps de la littérature : sauf qu’au lieu de « déterritorialiser » de manière subversive une langue centrale, il est question ici de transporter une « machine » affective dans la langue de sa mère, de procéder, dans les termes de Kiossev (1999), à une auto-colonisation émotionnelle de sa petite littérature.
Notes
On cite par exemple le cas de l’arménien István Petelei, du roumain-serbe Elek Gozsdu ou de l’allemand Ferenc Herczeg (Neubauer and Szegedy-Maszák 2006, pp. 170).
De nombreuses études ont montré l’importance des écoles d’officiers dans l’Empire austro-hongrois pour l’ascension sociale des minorités ethniques (Sigmirean 2000, 2015). On a aussi souligné que cette formation impliquait la bonne maîtrise des langues officielles de la Monarchie dualiste (Sigmirean 2000, pp. 28) et qu’elle engendrait parfois des vocations littéraires, le cas de Rebreanu n’étant pas singulier (Gheran 1986, pp. 157).
Sur l’activité littéraire de cette époque l’écrivain a laissé de nombreux aveux dont je cite seulement cette réponse à une enquête de 1927 : « dans un milieu de grande capitale et dans une époque de l’essor du théâtre, j’ai écrit environ cinquante pièces et livrets » (Rebreanu 1984, pp. 388) ou cette séquence d’une interview de 1935 : « J’ai commencé vite avec des pièces de théâtre, en grand nombre, que j’ai présentées partout à Budapest, sans résultat, bien entendu » (Rebreanu 1988, pp. 140). Les traductions des textes en roumain m’appartiennent.
La plupart des auteurs hongrois qu’il mentionne dans ses confessions (Gheran 1986, pp. 170) sont liés, par leur activité, au journalisme : Heltai Jenő (1871–1957), Szini Gyula (1876–1932), Vay Sarolta (1859–1918), Ambrus Zoltán (1861–1932), Ludwig von Dóczi (1845–1918) etc. J. Neubauer a souligné l’importance du métier de journaliste pour les milieux littéraires de Budapest à la fin du XIXe siècle, qui détermine aussi la cultivation des genres favorisés par les rythmes de la presse, comme la prose courte ou le feuilleton (Neubauer et al. 2004, pp. 253 ; Neubauer and Szegedy-Maszák 2006, pp. 170, 173).
On sait qu’il contacte deux des critiques littéraires roumains très importants, Mihail Dragomirescu et Garabet Ibrăileanu, qu’il propose des proses à l’une des revues culturelles les plus connues de l’époque, Viaţa românească, et qu’il gagne sa vie par une activité intense de chroniqueur théâtral (Rampa, Scena). Dans une interview, l’écrivain compare explicitement les conditions professionnelles des deux milieux littéraires : « ici [après le passage en Roumanie] commence un chapitre sombre de ma vie, une époque de lutte acharnée avec la misère et la passion d’écrivain, dans un milieu qui me donnait l’impression d’avoir descendu cinq marches par rapport à celui que je venais de quitter » (Rebreanu 1988, pp. 141).
Rebreanu occupe dès 1926 la fonction de président de la Société des Ecrivains Roumains.
Pour entrer dans le détail de ce qui circule entre les écrits hongrois et les écrits roumains de Liviu Rebreanu, je m’appuie sur l’édition en 23 volumes des archives et des œuvres de l’écrivain, réalisée par N. Gheran entre 1968 et 2005.
A Kaszát vásárló paraszt. Il semble que le texte ait été traduit par Liviu Rebreanu après la version allemande (Rebreanu 1968, pp. III, 438–439). Rebreanu a publié le texte comme « imitation » dans une revue roumaine (1913) et a repris le texte dans deux recueils, parus en 1919 et 1927.
References
Aristotel. (2004). Retorica [La Rhétorique] (Maria-Cristina Andrieş, Trans.). Bucureşti: Iri.
Casanova, P. (1999). La République mondiale des lettres. Paris: Seuil.
Casanova, P. (dir.) (2011). Des littératures combatives. L’internationale des nationalismes littéraires. Paris: Raisons d’Agir.
Deleuze, G., & Guattari, F. (1975). Kafka. Pour une littérature mineure. Paris: Minuit.
Deluermoz, Q., et al. (2013). Ecrire l’histoire des émotions : de l’objet à la catégorie d’analyse. Revue d’histoire du XIXe siècle, 47(2), 155–189.
Eliot, T. S. (1946). What is minor poetry? The Sewanee Review, 54(1), 1–18.
Frevert, U. (2011). Losing emotions. In Emotions in history—lost and found. Budapest: Central European University Press. http://books.openedition.org/ceup/1504. Consulté le 27 July 2017.
Gheran, N. (1986). Tânărul Rebreanu [Le jeune Rebreanu]. București: Albatros.
Gheran, N. (1989). Rebreanu, amiaza unei vieţi [Rebreanu, l’après-midi d’une vie]. București: Albatros.
Heinich, N. (2005). L’Elite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Paris: Gallimard.
Kiossev, A. (1999). Notes on self-colonizing cultures. In B. Pejić & D. Elliot (Eds.), After the wall. Art and culture in post-communist Europe (pp. 114–177). Stockholm: Moderna Museet.
Lahire, B. (2010). Franz Kafka. Eléments pour une théorie de la création littéraire. Paris: La Découverte.
Leerssen, J. (Ed.). (2017). National cultivation of culture. Leiden: Brill.
Lordon, F. (2014). La société des affects. Pour un structuralisme des passions. Paris: Seuil.
Moretti, F. (2000). Conjectures on world literature. New Left Review, 1, 54–68.
Nemoianu, V. (2002). National poets in the Romantic age: Emergence and importance. In A. Esterhammer (Ed.), Romantic poetry. IV (p. 249). Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.
Neubauer, J. (2010). Figures of national poets. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Neubauer, J., & Szegedy-Maszák, M. (2006). Topographies of literary culture in Budapest. In M. Cornis-Pope & J. Neubauer (Eds.), History of the literary culture of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th century, II (p. 162). Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
Neubauer, J., et al. (2004). 1867/1878/1881. In M. Cornis-Pope & J. Neubauer (Eds.), History of the literary culture of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th century. I (p. 241). Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.
Patriarca, S. (2012). Une émotion patriotique : la honte et le Risorgimento. Revue d’histoire du XIXe siècle, 44(1), 65–83.
Rebreanu, L. (1968). Opere [Œuvres]. I, III. (Eds. N. Gheran & N. Liu). Bucureşti: Editura Pentru Literatură.
Rebreanu, L. (1980). Opere [Œuvres]. XI. (Ed. N. Gheran). Bucureşti: Minerva.
Rebreanu, L. (1984). Jurnal [Journal]. I. (Eds. N. Gheran & P. F. Rebreanu). Bucureşti: Minerva.
Rebreanu, L. (1986). Romane [Romans]. I–III. (Ed. N. Gheran). Bucureşti: Cartea Românească.
Rebreanu, L. (1988). Interviuri [Interviews]. In A. Sasu, & M. Vartic (Eds.), Romanul românesc în interviuri [Le roman roumain en interviews]. III.1 (pp. 37–201). Bucureşti: Minerva.
Schlanger, J. (2008). La mémoire des œuvres. Paris: Verdier.
Sigmirean, C. (2000). Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania [L’histoire de la formation de l’intellectualité roumaine de Transylvanie]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Sigmirean, C. (2015). Romanian military elites in the Austro-Hungarian Empire’s army. In I. Boldea & C. Sigmirean (Eds.), Elites and the South-East European culture (pp. 21–34). Roma: Edizioni Nuova Cultura Roma.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Tudurachi, A. Réprimer le multilinguisme : la naissance d’un grand écrivain national dans les ruines de l’Empire. Neohelicon 45, 65–81 (2018). https://doi.org/10.1007/s11059-018-0425-1
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s11059-018-0425-1